Trump et la nostalgie de la Manufacturing Belt
Depuis son retour à la Maison-Blanche pour un second mandat, le président américain Donald Trump ne cesse de marteler un mot : TARIF. À ses yeux, il s’agit d’une panacée à tous les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés sur le plan international mais surtout une arme stratégique pour redéfinir les relations commerciales. Selon lui, les accords passés n’ont pas été équitables et ont conduit à la disparition de la Manufacturing Belt (ceinture industrielle), remplacée progressivement par la Rust Belt (ceinture de la rouille). Pour Trump, l’Amérique doit impérativement se réindustrialiser. Les entreprises américaines ayant délocalisé leur production en Asie doivent, selon lui, revenir au bercail.
Mais cette stratégie est-elle réellement gagnante ?
La chaîne de valeur, au cœur de la guerre commerciale
Pour mieux comprendre la situation à laquelle sont confrontées les entreprises américaines, il est essentiel de saisir le concept de chaîne de valeur et son rôle déterminant dans le commerce mondial.
Développée par Michael Porter, la chaîne de valeur désigne l’ensemble des activités qu’une entreprise réalise pour créer de la valeur pour ses clients : de la conception du produit à sa distribution, en passant par le service après-vente. Cela comprend l’approvisionnement, le stockage des matières premières, leur transformation en produits finis, la promotion, la vente, la gestion des fournisseurs, la recherche et développement, les ressources humaines, etc. L’objectif : identifier des sources d’avantages concurrentiels afin d’optimiser la valeur créée tout en minimisant les coûts.
À l’échelle mondiale, ces chaînes se sont fragmentées, donnant naissance aux chaînes de valeur mondiales (CVM). Chaque étape de la production est délocalisée là où elle est la plus efficiente, en fonction des coûts, des compétences disponibles et de l’accès aux marchés. Ce phénomène s’appuie sur deux piliers du libéralisme économique : la spécialisation et la libre circulation des biens, des services et des capitaux.
Relocaliser aux États-Unis : à quel prix?
L’administration Trump exhorte les entreprises, américaines ou non, à relocaliser leur production aux États-Unis pour échapper aux droits de douane. L’idée semble séduisante à première vue. Cependant, en y regardant de plus près, les défis sont nombreux.
D’abord, même si la production est relocalisée, les matières premières continueront à être importées, car aucun pays ne possède tous les avantages comparatifs. Les droits de douane continueront donc de s’appliquer sur ces importations, augmentant mécaniquement les coûts de production… et les prix à la consommation.
De surcroît, relocaliser demande du temps et de lourds investissements : infrastructures, technologies, formation de la main-d’œuvre, etc. Or, les États-Unis sont un pays à haut coût de la vie (HCOL). La main-d’œuvre y est parmi les plus chères au monde. Par exemple, un ouvrier payé 20 dollars par jour au Vietnam coûterait 20 dollars de l’heure aux États-Unis. Or, dans le secteur manufacturier, le coût du travail est un facteur déterminant.
En somme, revenir produire aux États-Unis signifie continuer à subir les droits de douane sur les intrants, supporter des coûts salariaux élevés, mobiliser d’importants capitaux pour former les employés et construire les infrastructures nécessaires. Cela entraînera inévitablement une hausse considérable des coûts de production.
Et le billet vert dans tout cela?
L’établissement du système de Bretton Woods en 1944 a permis au dollar américain de remplacer l’or comme principale monnaie de réserve internationale. Ce statut a été renforcé en 1971 sous la présidence de Richard Nixon avec le « Nixon Shock », qui a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Dès lors, le dollar n’a plus été adossé à l’or, mais à la puissance économique et militaire des États-Unis.
Le fait que le dollar soit devenu la monnaie de réserve mondiale a fortement stimulé les importations américaines, au détriment des exportations. En effet, une monnaie forte s’accompagne généralement d’un pouvoir d’achat élevé, ce qui a fait de la consommation le pilier de l’économie américaine en pourcentage du PIB. À l’inverse, les exportations américaines ont diminué, car les produits libellés en dollars sont devenus trop coûteux pour les consommateurs étrangers ne disposant pas du même niveau de pouvoir d’achat.
C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises américaines ont choisi de délocaliser leur production afin de réduire les coûts et rester compétitives sur le marché mondial. Revenir produire aux États-Unis impliquerait des coûts plus élevés, risquant de les faire perdre en compétitivité, sauf si elles optent pour une stratégie à double circuit : produire localement pour le marché intérieur et maintenir une production offshore pour les marchés étrangers.
La nostalgie américaine pour la « manufacturing belt » se comprend, mais dans un contexte où les États-Unis ont eux-mêmes encouragé un modèle de mondialisation fondé sur le libre-échange et le libéralisme économique, un retour en arrière semble difficile. D’autant plus qu’ils veulent maintenir l’hégémonie du dollar, augmenter leurs exportations, et atteindre une balance commerciale neutre voire excédentaire — autrement dit, avoir le beurre, l’argent du beurre et la crémière.
Lamana Cenatus
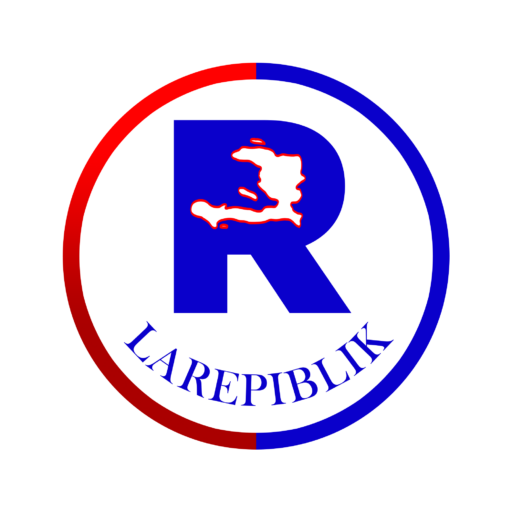




Laisser un commentaire